Extraits du livre de Paul Veyne : « Palmyre. L’irremplaçable trésor ».
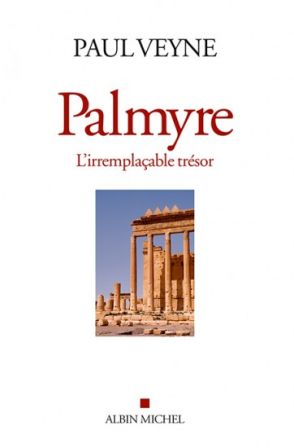
Actuelle victime de la barbarie terroriste, le site archéologique gréco-romain de Palmyre est peut-être le plus somptueux qui ait été dégagé par les fouilleurs avec Pompéi, près de Naples, et sur la côte turque, l’immense ruine d’Ephèse. Vers l’an 200 de notre ère, la cité appartenait au vaste empire romain, à son apogée en ce temps-là, qui s’étendait de l’Andalousie à l’Euphrate et du Maroc à la Syrie. Lorsque arrivait dans cette république marchande un étranger de passage, négociant, grec ou italien venu à cheval, Egyptien, Juif, magistrat envoyé par Rome, publicain ou soldat romain, bref citoyen ou sujet de l’Empire, le nouveau venu voyait au premier coup d’œil qu’il avait changé de monde.
(…)
Sur le site tel que les archéologues l’ont aménagé, aucune construction moderne n’est en vue ; le temps s’y est arrêté une fois pour toutes. Ce qui frappe le plus le visiteur contemporain est ce qui frappait déjà le voyageur antique : un grand sanctuaire, aujourd’hui explosé, et une longue colonnade, ces « rues de Palmyre, ces forêts de colonnes dans les plaines du désert » dont rêvait Hölderlin enfant. Le commerce avec le vaste monde avait transfiguré cette oasis araméenne, de même qu’il fera une Venise de quelques îlots boueux sur l’Adriatique. La colonnade représentait l’urbanisme d’avant-garde et la vie de tous les jours, le sanctuaire du dieu Bêl était le Saint-Marc de ce port du désert.
(…)
Qui a financé cet ensemble monumental ? Nous l’ignorons. Trois réponses sont possibles : les bénéfices commerciaux obtenus sur les routes de la Soie, la piété de nombreux pèlerins, la famille impériale romaine. De riches fidèles ont pu, par exemple, offrir chacun une ou deux colonnes, selon une pratique courante alors. Un empereur ou un prince impérial a pu en faire cadeau à la cité lors de son rattachement à l’Empire. Ou enfin le trésor du sanctuaire lui-même a fait la dépense.
(…)
La colonnade n’était pas une voie de circulation ; qu’on ne se figure pas des caravanes en train de la longer : elles n’entraient sûrement pas dans la ville. Sur une partie de sa longueur, la grande avenue était le souk de Palmyre, « le portique où on vend de tout », comme on l’appelait, et l’endroit où flâner. Un souk à la forme régulière géométrique, conforme à la rationalité d’une civilisation avancée, et qui formait un tout refermé sur lui-même, un endroit où l’on allait plutôt qu’un passage. C’est une utilisation des espaces publics qui n’est pas la nôtre.
(…)
Palmyre ne ressemblait à aucune autre cité de l’Empire. Que son art soit primitiviste, oriental, hybride ou hellénisant, que ses temples aient ou non des fenêtres, que ses notables portent un vêtement grec ou arabe, qu’on y parle l’araméen, l’arable, le grec et même, dans les grandes occasions, le latin, on sent souffler sur Palmyre un frisson de liberté, de non-conformisme, de « multi-culturalisme ». Le lecteur s’en souvient, tout est venu se mêler à Palmyre, Aram, Arabie, Perse, Syrie, hellénisme, Orient, Occident. Et pourtant, comme aussi sa voisine Emèse, elle est toujours restée elle-même, ni hellénisée ni romanisée en sa multiplicité. Loin d’aboutir à l’universelle uniformité, tout patchwork culturel, avec sa diversité, ouvre la voie à l’inventivité.
(…)
Oui, décidément, ne connaître, ne vouloir connaître qu’une seule culture, la sienne, c’est se condamner à vivre sous un éteignoir.